Publié par Harvey Mead le 29 Fév 2016 dans Blogue | 10 commentaires
La chronique de Josée Blanchette dans Le Devoir du 26 février reprend un thème qui me préoccupe depuis longtemps, soit l’incapacité des groupes de la société civile à intervenir là où ils savent que c’est essentiel. Je notais dans mon dernier article que les questions de démographie semblent aboutir souvent à des dérapages dans les analyses même des experts. Dans la chronique de Blanchette, c’est la question de la viande et des impacts des élevages, et donc de la consommation de la viande elle-même. Le visionnement de Cowspiracy (une heure et demi qui valent la peine) est déconcertant par la masse d’informations fournies que nous connaissions déjà en bonne partie, mais qui insiste.
Dans les entrevues qu’elle a faites avec Laure Waridel et avec Karel Mayrand pour la chronique, ces deux soulignent la difficulté d’intervenir face aux défis, Mayrand ajoutant celui du rôle de l’automobile dans notre civilisation. Dans mon prochain article, je vais revenir sur cette problématique en commentant le document de Greenpeace International sur le potentiel des énergies renouvelables (100% de capacité à fournir l’énergie requise par l’humanité…).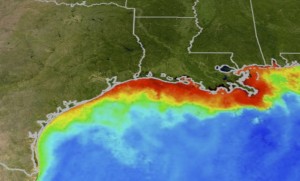
Ce qui frappe dans la brève citation de Mayrand est son constat que la population ne tolère pas des interventions touchant les «dogmes» de la société – et son rejet des critiques des groupes par Cowspiracy, critiques difficiles à contourner. Ensemble, l’attachement à la viande et à l’auto représente quand même des enjeux touchant une bonne partie des émissions responsables pour les changements climatiques, mais aussi – c’est l’accent de Cowspiracy – la perte directe de biodiversité dans toutes ces formes pour produire la viande, en complément à la perte «indirecte» que représente la menace des changements climatiques. Ajouter à cela un discours insistant sur une réduction dramatique de notre consommation de produits de l’industrie et nous sommes devant une situation où on comprend plus facilement l’incapacité des gouvernements à développer des plans d’action en la matière : les populations des pays riches sont fortement investies dans des comportements qui sont en contradiction avec les changements requis pour éviter la catastrophe.[1]
Rôle de la société civile – et des individus
Par pure coïncidence, je viens de commencer la lecture du livre de Gar Alperovitz, America Beyond Capitalism (2005), suite à des références de Gus Speth. Et voilà, dès les premiers paragraphes, ce militant de la première heure se situe, nous situe :
It is not only necessary but possible to « change the system ».. When I worked in the Senate in the early 1960s, it was for Gaylord Nelson – the founder of Earth Day. The idea that environmental issues might one day become important in America seemed far-fetched then. Everyone knew this was a nonstarter. I witnessed close at hand the rise from « nowhere » of what once had been called « conservation » to become the « environmental movement ». I view current setbacks and political obstacles with a certain historical sense of the possible, and I view long-run change coming « out of nowhere » as always – minimally! – conceivable.[2]
Derrière les brefs commentaires de Waridel et Mayrand dans la chronique de Blanchette se trouve un constat troublant. Quand les groupes constatent que les défis qu’il faut relever vont à l’encontre de «dogmes» de la population (tels qu’ils les conçoivent), ils réorientent leurs interventions pour éviter de se «faire ramasser». Ils interviennent régulièrement maintenant – depuis longtemps, en fait, et vertueusement – pour un meilleur aménagement de nos villes et pour un transport en commun plus efficace. Ils savent en même temps que de tels objectifs sont devenus des priorités parce que notre affaire avec l’automobile a fait dévier nos interventions sociétales depuis des décennies, et vont empêcher la reconnaissance des objectifs qu’ils prônent. Cela tant que l’automobile restera au cœur de notre société de consommation.[3] Il est impératif que le «mouvement environnemental» cible aujourd’hui des changements systémiques nouveaux par rapport à ceux des années 1960.
Je viens de recevoir un message de la Fondation David Suzuki, où Mayrand est le directeur général, intitulé «Accumulez-vous des milles Aéroplan?». Je m’attendais naïvement à une intervention soulignant que la vie des babyboomers à la retraite (probablement pas leur membership de base…) centrée sur des voyages se bute à une autre source d’émissions importante: le transport aérien constitue le secteur des transports le plus difficile à gérer en matière de réductions de gaz à effet de serre (GES). Il n’en était rien pour le message : la Fondation sollicite le don des milles de ses membres pour permettre les «déplacements essentiels» de ses dirigeants (comme pour la COP21 en novembre-décembre). Ces dirigeants peuvent appuyer les constats de Blanchette, et aller plus loin pour constater que l’agriculture est peut-être même la plus importante source d’émissions de GES, avant les transports (lire : l’automobile); leurs interventions en matière d’agriculture et d’alimentation restent bien timides à cet égard, comme celles face à l’auto.
Je ne sais même pas comment me situer moi-même dans tout ceci. J’ai soupé avec les responsables de l’Association humaniste avant ma présentation chez eux il y a deux semaines, et j’ai commandé un repas d’agneau, viande que j’aime beaucoup et qui n’est pas souvent au menu. Un peu plus tard, un membre de l’Association s’est joint à nous. C’est quelqu’un qui commente mon blogue de temps en temps, et il s’est exclamé en voyant mon assiette : vous mangez de la viande?! Lors du dîner le même jour, un autre ami a noté que j’avais choisi le couscous aux merguez, alors qu’il s’était permis de présumer que j’aurais choisi le couscous végétarien, juste au-dessus dans le menu. Comme pour l’agneau du souper, je ne mange pas souvent le merguez, et je profitais de l’occasion. Finalement, comme Mayrand, je suis omnivore, et comme Pineau, pas végétarien en partie pour des raisons familiales. Cela ne diminue pas le fait que, au minimum, la limitation de la viande à un rôle de condiment pour des plats surtout végétariens est incontournable dans nos sérieux efforts de concevoir l’avenir.
Pire, comme Mayrand, je me suis permis plusieurs voyages ces dernières années, voyages dont les GES qui leur étaient associés étaient probablement à chaque fois plus importantes par deux fois que celles de ma Prius pendant l’année. Je sentais une certaine culpabilité en faisant ces voyages «essentiels» en Chine, mais mon alternative était de tout simplement rester chez nous. J’y suis allé donc quatre fois, et peu importe qu’ils n’étaient pas pour le plaisir, mais pour mieux comprendre le fonctionnement de ce pays où mon journaliste d’antan ne voit que celui d’un pouvoir dictatorial mais que je vois comme offrant des pistes pour le changement systémique qui s’imposera, je fonçais dans les émissions.
À la fin de mon voyage de 2011, lors d’une rencontre avec le directeur de l’Institut d’études urbaines et environnementales de la Chinese Academy of Social Sciences à Beijing, j’échangeais avec lui sur le rôle de l’automobile en Chine. Le contexte : sa correction de mon sens que les réserves de charbon de la Chine étaient de près de 200 ans, réserves qu’il ramenait à environ 45 ans. Le charbon est pourtant presque inévitablement la source de l’électricité pour alimenter la flotte d’automobiles que la Chine voudrait augmenter dramatiquement. Et face à notre constat de la congestion déjà impressionnante dans les villes chinoises, il ajoutait : le Chinois de la classe moyenne pourra facilement se satisfaire de tout simplement voir et faire voir son auto stationnée dans sa petite cour en avant, sans même l’utiliser…
Les travaux récents du DDPP et de Greenpeace International mettent de l’avant, parce que c’est incontournable, un changement «systémique» – pour reprendre le terme d’Alperovitz – dans les transports, mais c’est fascinant de voir comment cela est saupoudré d’une reconnaissance un peu partout que l’automobile domine et va continuer à dominer, de toute évidence. Le changement systémique relève du rêve dans ces travaux, qui cherchent à formuler les pistes pour permettre d’atteindre non seulement les pistes de l’Accord de Paris, beaucoup trop restreintes, mais un changement systémique dans la société elle-même. Ils n’y arrivent qu’à force d’énormes efforts de l’imagination.
Nos vies remplies de contradictions appellent une meilleure prise de conscience et un meilleur comportement. Reste que nos gestes comme individus, même dans les pays riches, ne représentent pas le changement systémique qu’il faut tant que nous n’aurons pas atteint la masse critique, le rejet des dogmes et des comportements en train de saccager notre seul milieu de vie, non seulement chez nous, mais sur la planète entière.
Le «dogme» démographique
Reste donc à comprendre les groupes, qui semblent ainsi reconnaître, par deux de ses intervenants les plus connus, qu’ils ne s’attaquent pas aux principaux défis qui menacent quand même la civilisation elle-même. Pierre-Olivier Pineau complète le portrait assez bien dans la chronique, soulignant l’intertie qui nous empêche de prendre les décisions qui s’imposent. C’est intéressant à cet égard de revoir un autre échange dans la chronique de Blanchette pendant la COP21 au début de décembre. Waridel et Mayrand y étaient encore en cause.
Blanchette racontait la réflexion d’une étudiante dans le cours qu’elle avait visité : «Isabelle soulève la question des enfants : « Le géographe et professeur Rodolphe de Koninck dit que, dans un monde ‘soutenable’, on ne devrait pas avoir d’enfant. En tout cas, pas plus qu’un »». La semaine suivante, De Koninck corrigeait le tir pour Blanchette :
La semaine dernière, une étudiante interviewée ici a prêté des propos sur la natalité et la surpopulation au professeur et géographe Rodolphe De Koninck. Celui-ci m’a écrit pour rectifier les faits et me dire qu’au contraire, il ne préconise en rien la dénatalité : «Je pense plutôt qu’il faut fournir aux familles qui le souhaitent la possibilité d’avoir au moins deux enfants. […] La surpopulation est un mythe, le problème démographique, s’il en est un, ne relevant nullement du nombre d’habitants de la planète, mais bien de la façon dont une minorité d’entre eux l’habitent. Cette minorité prédatrice se retrouve essentiellement dans les pays riches.» Toutes mes excuses au nom de l’étudiante pour cette interprétation imaginative.
 Finalement, De Koninck revient indirectement dans ce commentaire sur un court texte qu’il a écrit dans Les nouveaux cahiers du socialisme : La décroissance pour la suite du monde (n.14, 2015). «Une décroissance de la production agricole mondiale est-elle souhaitable?» souligne le caractère prédateur et destructeur de l’agriculture industrielle et propose qu’une agriculture paysanne pourrait mieux nourrir la population humaine. Sous-entendu dans le texte, en partie, et qu’il ne rend pas explicite, est ce qui est présenté directement dans Cowspiracy. C’est que l’on ne peut proposer cela, et se permettre des familles «normales», que dans une perspective qui réduit dramatiquement l’empreinte écologique de la minorité prédatrice de l’humanité, les populations des pays riches.
Finalement, De Koninck revient indirectement dans ce commentaire sur un court texte qu’il a écrit dans Les nouveaux cahiers du socialisme : La décroissance pour la suite du monde (n.14, 2015). «Une décroissance de la production agricole mondiale est-elle souhaitable?» souligne le caractère prédateur et destructeur de l’agriculture industrielle et propose qu’une agriculture paysanne pourrait mieux nourrir la population humaine. Sous-entendu dans le texte, en partie, et qu’il ne rend pas explicite, est ce qui est présenté directement dans Cowspiracy. C’est que l’on ne peut proposer cela, et se permettre des familles «normales», que dans une perspective qui réduit dramatiquement l’empreinte écologique de la minorité prédatrice de l’humanité, les populations des pays riches.
On voit ici une sensibilité envers une autre des problématiques («s’il en est une», dit De Koninck) marquant notre civilisation, où on a vu la population humaine tripler pendant une seule vie humaine (la mienne); c’était un comportement de cervidés dont on connaît le cycle de vie… On voit la même sensibilité dans les sources de l’article d’Yves-Marie Abraham que j’ai commenté dans mon dernier article et même chez Abraham lui-même. Le titre de son article, «Moins d’humains ou plus d’humanité ?» signalait par indirection et suggestion, comme chez DeKoninck – par le questionnement – , une profonde critique de notre style de vie prédateur, sans pour autant rejeter du revers de la main le défi que représente l’effort de bien vivre de la part de 7,5 milliards d’humains (avec plus à venir) sur cette planète sérieusement endommagée.
L’UQCN (ancien nom de Nature Québec) s’est «faite ramasser» – pour utiliser l’expression de Mayrand – en intervenant sur la question en 1991 dans son magazine Franc-Nord par une chronique «Une politique familiale … ou nataliste ?» de Luc Gagnon et Jean-Pierre Drapeau (vol.8. n.4, p.9-12), cela faisant suite à un éditorial de son CA l’automne précédent (j’en étais président). La réponse d’un chroniqueur du Journal de Montréal : les deux auteurs étaient des crétins… Les crétins sont toujours à l’œuvre et même si, comme pour Alperovitz, ils ne semblent pas réussir, cela ne semble pas être une justification pour poursuivre dans des efforts de sensibilisation de la population et des décideurs qui détournent l’attention des véritables objectifs qui s’imposent…
MISE À JOUR (en fait, c’est du rattrapage…) le 15 mars 2016
Dans une intéressante note de recherche publiée au début de février, l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) intervient là où certains groupes semblent réticents. La note, «Le transport en commun comme solution à la relance économique et à la crise environnementale au Québec», fournit une analyse de stratégies économiques en matière de transports, pas mal dans la lignée des efforts des économistes hétérodoxes de maintenir le modèle économique actuel, et la contribution la plus intéressante est plutôt ailleurs.
La note de l’IRIS montre que la voiture électrique ne représente pas une piste intéressante pour répondre aux enjeux touchant le transport des personnes et sa dépendance totale aux énergies fossiles; en fait, il montre que le transport par véhicule privé ne représente pas une piste intéressante. Comme la note le souligne, une telle orientation est à l’envers de celles marquant les projets d’investissements du gouvernement du Québec pour la prochaine décennie. Par contre, un remaniement ministériel récent a mis un membre de l’équipe économique du gouvernement Couillard à la tête du ministère des Transports…
Cela est dans le contexte québécois, et lorsque la réflexion est étendue aux défis globaux, le constat est encore plus frappant dans son rejet de l’approche technologique en appui à l’intérêt individuel. La note sert de rappel pour d’autres interventions antérieures dans le domaine. En 2011, Vivre en ville et Équiterre ont publié Changer de direction : Pour un Québec libre de pétrole en 2030. Il s’agissait d’une belle synthèse des connaissances acquises à travers le monde doublée d’un ensemble de propositions tout à fait cohérentes et qui allait dans le sens d’une réduction dramatique du recours à l’automobile privée. Il insistait qu’«assumer pleinement l’objectif de réduire l’utilisation et le nombre d’automobiles» n’était pas «une déclaration de guerre à la voiture, qui a tout à fait sa place au sein d’un ‘cocktail transport’ bien dosé» (69) mais le rapport est quand même assorti de suggestions sur des «dissuasions concrètes à l’endroit du trafic automobile» (85). Le travail était également assez perspicace face à l’idée que l’électrification va régler les problèmes (99-10. Il termine, comme c’est le mot d’ordre depuis des années maintenant et presque sans effet, avec une conclusion intitulée «L’urgence d’agir»…
Il semble que presque tout ce qui a été retenu des interventions visant des changements radicaux dans les transports depuis cinq ans est justement le rêve technologique et l’idée d’électrifier les transports. En 2013, Pierre-Olivier Pineau était intervenu déjà dans le journal Nouveau projet (…) pour souligner que c’était une fausse piste, ce qui devient encore plus évident avec cette récente note qui sert, finalement, de rappel. Même si les groupes ne se font pas toujours ramasser, ils n’ont pas toujours beaucoup d’impact.
Pour le sens contraire de la situation venant des promoteurs de l’économie verte, dont Dialogues pour un Canada vert, voir le blogue de Pierre Langlois du 7 mars dernier, fondé sur l’expansion énorme du transport électrique.
[1] Dans mon article sur le post COP21, je note la critique de Marc Jaccard à l’effet que le marché de carbone et les taxes sur le carbone ne représentent pas des interventions efficaces parce qu’ils exigent aux gouvernements d’aller à l’encontre, et explicitement, des dogmes de la population – ce qu’ils ne feront pas. Sur cette question, voir aussi l’article de Christian Simard mentionné dans la note 2.
[2] Alperovitz se penche sur des enjeux socio-politiques, et a publié un autre livre en 2013, What Then Do We Do?. Un récent article de février 2016 commente même la campagne de Bernie Sanders. Évidemment, le défi pour ceux qui s’attaquent aux enjeux touchant les fondements écosystémiques de tout développement socio-politique sont différents, peut-être encore plus exigeants.
[3] Le matin même que j’écrivais ces lignes, Christian Simard de Nature Québec intervient avec un texte dans Le Devoir qui associe justement une diminution du nombre d’autos avec les questions d’aménagement et de transport en commun.


 by
by  Lire la suite
Lire la suite

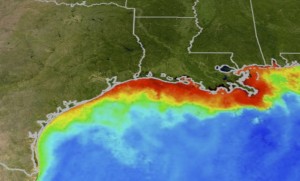


 nces au budget carbone et celles-ci ne fournissent pas de réponses à la question). Ni une recherche ni un examen de la table des matières ne permet pas de voir si le travail cherche à atteindre une convergence dans l’utilisation de l’énergie par les quelque 9 milliards de personnes prévues; un coup d’oeil aux résultats pour l’OCDE et l’Afrique suggère qu’il y a des différences importantes qui restent en 2050 dans la consommation d’énergie par les différentes populations du monde. En parallèle à cela,
nces au budget carbone et celles-ci ne fournissent pas de réponses à la question). Ni une recherche ni un examen de la table des matières ne permet pas de voir si le travail cherche à atteindre une convergence dans l’utilisation de l’énergie par les quelque 9 milliards de personnes prévues; un coup d’oeil aux résultats pour l’OCDE et l’Afrique suggère qu’il y a des différences importantes qui restent en 2050 dans la consommation d’énergie par les différentes populations du monde. En parallèle à cela, 
